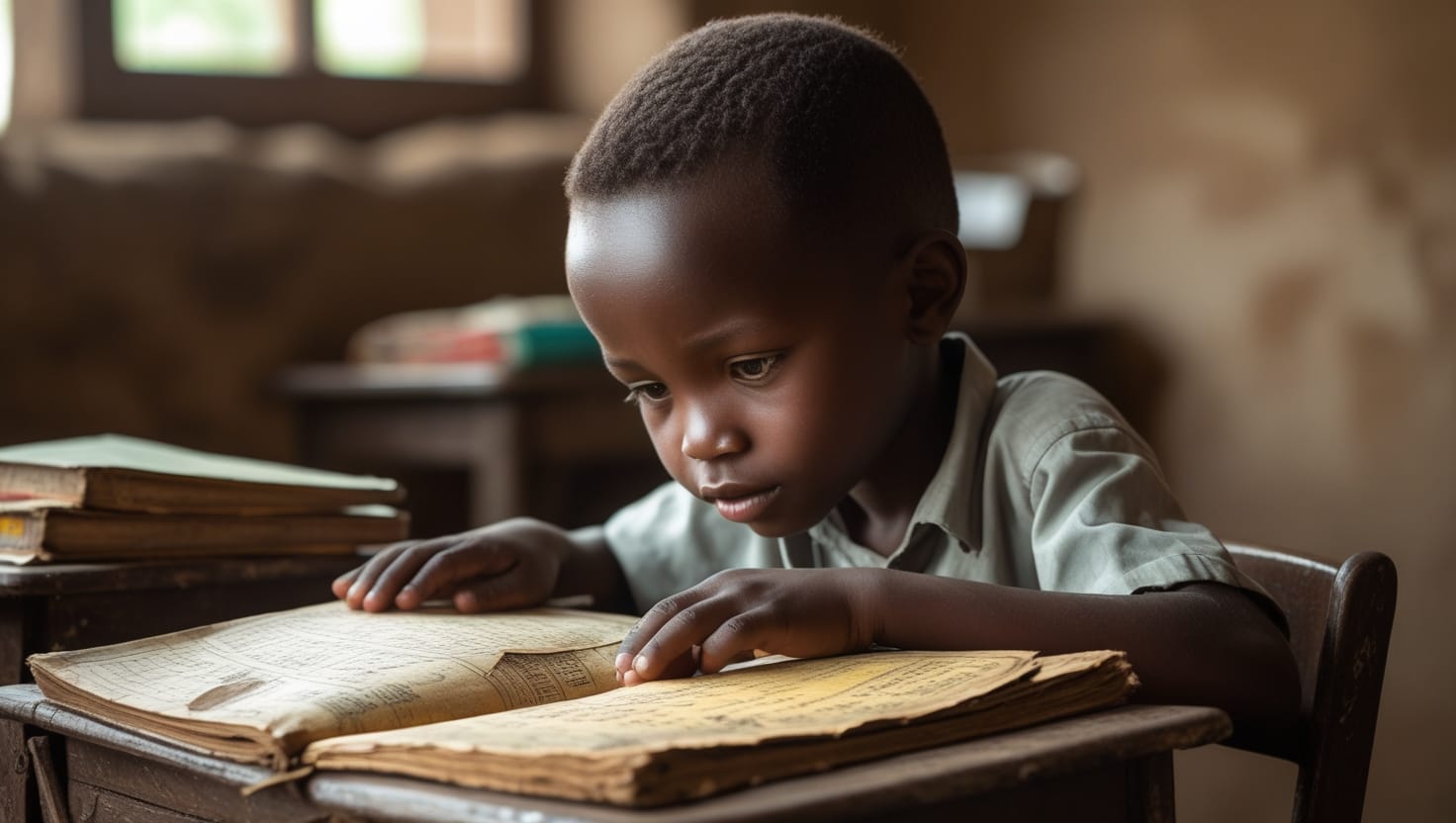À l’heure où la désinformation se propage rapidement et où les jeunes sont de plus en plus exposés aux contenus numériques, intégrer l’éducation aux médias et à l’information (EMI) dans les programmes scolaires africains est une nécessité urgente, à la fois éducative et citoyenne.
Avec la croissance fulgurante d’Internet et des réseaux sociaux, la jeunesse africaine est devenue la principale consommatrice d’information en ligne. Le pourcentage d’Africains utilisant les réseaux sociaux est passé d’environ 25 % en 2021 à 35 % en 2024, soit plus de 276 millions d’utilisateurs. Cette révolution numérique, facilitée par la généralisation des smartphones et des connexions mobiles, entraîne une diffusion massive de contenus, souvent non vérifiés.
Blaise-Pascal Andzongo, président de l’ONG Eduk-Media et représentant Afrique de l’Alliance UNESCO pour l’EMI, alerte sur la prolifération des fausses informations sur Internet et les réseaux sociaux. Ce phénomène sape la confiance envers les médias traditionnels et les institutions, mettant en péril la cohésion sociale.
Des campagnes de désinformation aux conséquences dramatiques
Plusieurs pays africains, tels que le Mali, le Burkina Faso ou encore la République centrafricaine, sont confrontés à des campagnes de désinformation d’ampleur, à visée politique ou idéologique, orchestrées par des acteurs étatiques, paraétatiques ou étrangers. En Centrafrique, par exemple, le groupe Wagner a mis en place un vaste réseau de propagande en s’appuyant sur des journalistes locaux rémunérés pour diffuser des messages haineux et des fausses informations au profit des intérêts russes, tout en attisant la haine contre les forces internationales comme la Minusca et certains pays occidentaux.
Les conséquences de ces opérations sont lourdes : elles exacerbent les conflits existants, ravivent les tensions sociales et ethniques, et menacent directement la sécurité publique. La désinformation devient ainsi un outil de déstabilisation politique, alimentant la méfiance envers les institutions, divisant les communautés et compliquant la résolution pacifique des crises.
Les enjeux de l’éducation aux médias et à l’information
Malgré les effets dévastateurs de la désinformation, l’EMI reste quasi absente des programmes scolaires africains. Elle est parfois abordée en cours d’éducation civique ou de technologie, mais sans méthodologie dédiée ni formation adaptée pour les enseignants. Ce sont principalement les ONG et la société civile — comme Eduk-Media au Cameroun, ou des associations en Côte d’Ivoire, Namibie et Kenya — qui portent l’effort de sensibilisation, souvent grâce à des financements internationaux.
L’éducation aux médias ne se limite pas à l’identification des fausses informations. Elle vise à donner aux élèves les clés pour comprendre le fonctionnement des médias, repérer les biais cognitifs et décrypter les stratégies de persuasion. Au Mali, le programme "Learn to Discern" joue un rôle essentiel dans le développement des compétences critiques des jeunes face à la désinformation. Mis en place par l’International Research & Exchanges Board (IREX), il forme les participants à distinguer mésinformation, malinformation et désinformation, tout en les sensibilisant aux mécanismes de manipulation en ligne.
De façon concrète, Learn to Discern propose des modules interactifs permettant aux jeunes et aux enseignants d’acquérir des outils pratiques pour évaluer la fiabilité des sources, analyser les contenus médiatiques et adopter un comportement responsable sur les réseaux sociaux. Soutenu par des partenaires comme l’UNESCO, ce programme a déjà été intégré dans plusieurs formations au Mali, touchant aussi bien des jeunes de la société civile que des enseignants. Il contribue ainsi à former une citoyenneté numérique critique et engagée.
Dans le contexte africain, l’EMI ne peut se résumer à des actions isolées. Comme le souligne Maimouna Touré, coordinatrice du programme KIX francophone Africa 21 à l’Organisation internationale de la Francophonie, il est essentiel de mettre en place des stratégies régionales et multisectorielles impliquant les ministères de l’Éducation, la société civile, les institutions internationales et les experts du numérique.
Le programme KIX francophone Africa 21 illustre cette dynamique en encourageant le partage de bonnes pratiques, la formation des enseignants et la création de ressources pédagogiques adaptées aux réalités africaines. Il met également l’accent sur l’intégration effective de l’EMI dans les curricula nationaux, en tenant compte des mutations technologiques, notamment l’impact croissant de l’intelligence artificielle sur l’information.
L’EMI vise aussi à transmettre les droits numériques fondamentaux, comme la protection des données personnelles et de la vie privée. Elle encourage un usage éthique des réseaux sociaux, en incitant les jeunes à participer de façon constructive au débat public et à produire des contenus responsables. Sur un continent où la jeunesse est très active en ligne, ces compétences sont essentielles pour consolider la démocratie et favoriser le vivre-ensemble.
Obstacles majeurs et recommandations pour agir
Le principal défi reste la formation des enseignants. En Afrique, moins de 15 % des enseignants du secondaire maîtrisent les outils numériques de base. Il est donc urgent de développer des programmes de formation continue, incluant des modules obligatoires dans les écoles normales, ainsi que de créer des centres régionaux spécialisés. Le modèle proposé par l’International Center for Journalists (ICFJ) en Afrique de l’Ouest — quatre semaines de formation en ligne suivies d’un mentorat — constitue une initiative prometteuse à généraliser.
Par ailleurs, les budgets éducatifs consacrés au numérique demeurent très limités, souvent inférieurs à 0,3 % en Afrique subsaharienne. La création d’un fonds continental dédié à l’EMI, appuyé par des partenariats public-privé, permettrait de financer l’équipement des écoles, le développement de plateformes pédagogiques et la production de contenus adaptés aux contextes locaux.
Enfin, la recherche scientifique sur l’EMI en Afrique reste embryonnaire. Pourtant, elle est essentielle pour ajuster les politiques éducatives aux réalités socioculturelles et linguistiques du continent.
L’intégration de l’éducation aux médias dans les programmes scolaires africains est donc une urgence politique et pédagogique. Elle représente un levier stratégique pour former des citoyens critiques, responsables et résilients face à la désinformation numérique. Comme l’a affirmé Blaise-Pascal Andzongo, il s’agit d’un véritable défi civilisationnel : préparer la jeunesse africaine à penser et construire l’Afrique numérique de demain, dans un monde où l’information est à la fois un bien commun et un enjeu de pouvoir.