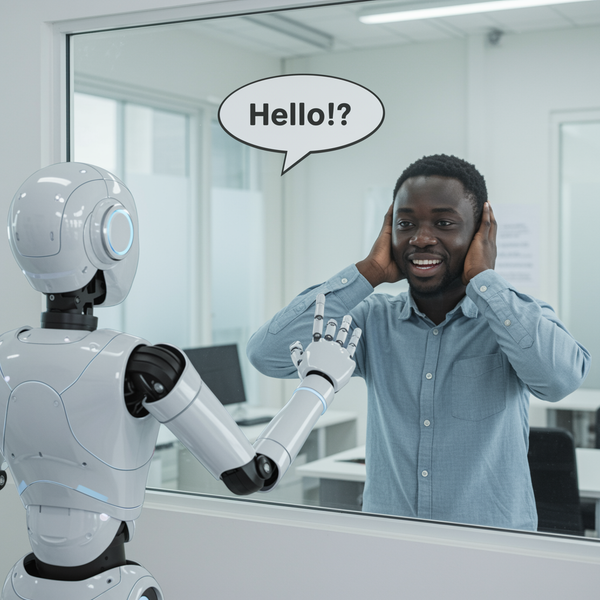Au Mali, le journalisme n’est plus seulement un métier : c’est un exercice de survie. Entre les pressions des autorités militaires qui exigent un traitement « patriotique » de l’information et les menaces constantes des groupes armés, les journalistes doivent naviguer dans un espace où chaque mot peut devenir dangereux.
Depuis les coups d’État de 2020 et 2021, les journalistes maliens sont confrontés à une situation inédite. D’un côté, les autorités militaires demandent une couverture alignée sur leur vision, imposant un traitement « patriotique » de l’information et censurant toute critique perçue comme déstabilisatrice. De l’autre, des groupes armés actifs dans le nord et le centre du pays rendent certaines zones inaccessibles et menacent physiquement ceux qui s’y aventurent.
Dans ce contexte, informer relève d’un double courage : celui de résister à la censure officielle et celui de risquer sa vie sur le terrain.
La pression du traitement « patriotique » et la censure officielle
En théorie, les médias et les journalistes maliens bénéficient d’une certaine liberté, et les médias privés conservent une indépendance relative. Dans la pratique, toutefois, le journalisme est devenu beaucoup plus difficile en raison de la situation politique et de la posture de plus en plus ferme de la junte au pouvoir. La pression pour présenter l’information de manière « patriotique » s’intensifie, tandis que les correspondants étrangers sont désormais considérés comme indésirables.
La Haute Autorité de la Communication (HAC), organe régulateur des médias, ainsi que les médias d’État, sont entièrement soumis aux responsables gouvernementaux, qui peuvent limoger leurs dirigeants à tout moment.
La suspension de Joliba TV fin 2024, suite à une plainte déposée par son homologue burkinabè, a suscité de vives inquiétudes quant à un contrôle régionalisé de l’information. Par ailleurs, la HAC a interdit aux médias de couvrir toute activité politique, restreignant encore davantage l’espace d’expression journalistique.

La menace des groupes armés
Parallèlement, certaines zones du Mali échappent au contrôle de l’État. Le nord et le centre du pays sont régulièrement le théâtre d’attaques de groupes djihadistes et de milices armées. Les journalistes qui tentent de s’y rendre sont exposés à l’enlèvement, au meurtre ou à l’intimidation.

En avril 2021, le journaliste français Olivier Dubois a été enlevé à Gao par un groupe djihadiste et retenu 711 jours. En novembre 2023, Abdoul Aziz Djibrilla, journaliste à Radio Naata, a été tué sur la route Gao-Ansongo, et deux de ses collègues ont été kidnappés. Ces incidents rappellent que le métier est une activité à haut risque.
Stratégies de résilience et innovation journalistique
Face à cette double menace, les journalistes maliens développent des stratégies pour continuer à informer. Les médias communautaires dans les langues locales couvrent des zones inaccessibles aux grands médias nationaux. Les réseaux d’entraide et formations sur la sécurité numérique et physique permettent de limiter les risques. Certains journalistes collaborent avec des plateformes internationales de fact-checking pour contourner la censure.
Informer au Mali n’est pas un métier ordinaire : c’est un acte de bravoure face aux autorités et aux groupes armés. Chaque reportage témoigne de la résilience des journalistes et de leur engagement envers le droit à l’information, malgré le risque.