Ecrit par Abdoussalam DICKO
Populaire et accessible, la revue de presse au Mali captive les foules. Mais mal encadrée, elle devient un canal majeur de rumeurs et de fake news. Et si on la transformait en arme contre la désinformation ?
« Chez nous, la revue de presse n’a rien d’académique. On n’y résume pas les grands titres, on ne replace pas les articles dans leur contexte, on ne propose pas d’analyse critique. Très souvent, c’est de l’opinion, du commentaire personnel, voire du règlement de comptes », explique Boubacary Bocoum, journaliste indépendant et correspondant de plusieurs agences internationales.
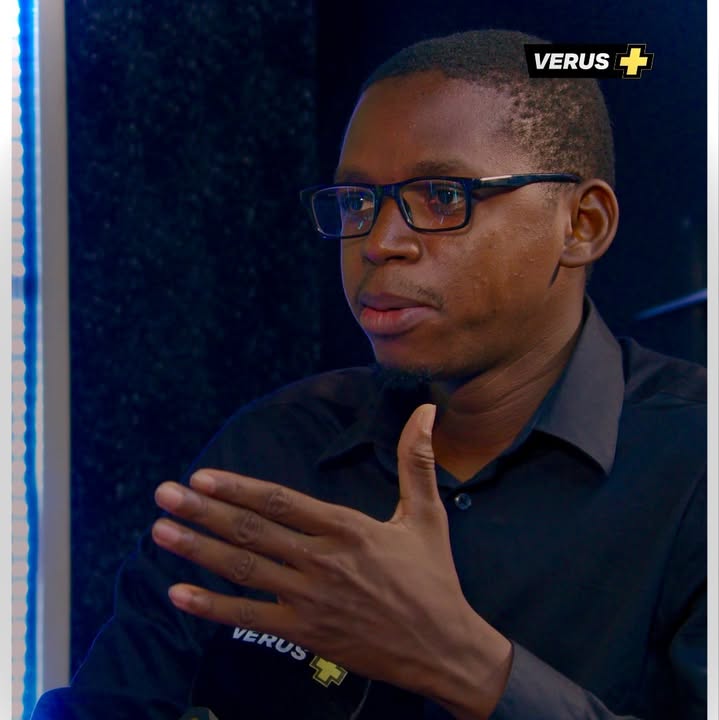
Dans les radios maliennes, la revue de presse s’éloigne souvent de sa vocation initiale pour devenir un puissant vecteur de désinformation, dans un pays où l’oralité demeure le principal mode de communication. En 2025 encore, la radio reste la première source d’information au Mali, avec plus de 170 stations en activité à travers le territoire.
Des dérives fréquentes
Il arrive que certains chroniqueurs aillent jusqu’à passer commande d’articles à des journalistes, non pas pour éclairer l’opinion, mais pour disposer de matière à exploiter ensuite dans leur revue. Dans ces conditions, la pratique s’éloigne de l’information pour se rapprocher d’une stratégie de mise en scène, où l’indépendance de la presse est gravement compromise.
Plus inquiétant encore, la revue de presse sert parfois d’outil de pression. Certains chroniqueurs n’hésitent pas à se livrer à de véritables formes de chantage, en ciblant des personnalités publiques ou politiques : ils grossissent certains faits, insinuent des accusations ou menacent de porter une affaire sur la place publique, avant de se raviser… Contre des faveurs ou des avantages en coulisses.
Dans d’autres cas, le mécanisme inverse se produit : des agissements douteux sont volontairement minimisés, voire blanchis à l’antenne, afin de redorer l’image de tel responsable ou de protéger des alliés.
À cela, s’ajoute le fait que la revue de presse est parfois confiée à des personnes sans formation journalistique, choisies pour leur aisance verbale, leur humour ou leur sens du spectacle. Dès lors, l’exercice glisse du travail critique vers une forme de théâtre radiophonique, où l’on rit des malheurs judiciaires d’un adversaire, où l’on protège les amis, et où la vérité finit par disparaître derrière la manipulation et la mise en scène.
Des pistes pour transformer la revue de presse
Pour que la revue de presse malienne joue pleinement son rôle d’information, il est nécessaire d’en encadrer les pratiques. Les autorités de régulation, notamment la Haute Autorité de la Communication (HAC), doivent veiller activement au respect des règles déontologiques. Sanctionner les cas de diffamation ou de désinformation n’est plus une option, mais une nécessité pour protéger le public.
Il est aussi temps de professionnaliser les voix qui portent ces émissions. Qu’ils soient journalistes ou chroniqueurs populaires, les intervenants doivent être formés aux bases du journalisme : vérification des faits, contextualisation, sens des responsabilités. L’oralité ne doit pas rimer avec improvisation dangereuse.
Les patrons de presse ont, eux aussi, un rôle clé à jouer. Même si la revue de presse attire de l’audience, elle ne doit pas devenir un spectacle au détriment de la crédibilité. Investir dans des formats vivants mais rigoureux, adaptés au public local, est un choix stratégique pour l’avenir du secteur.
Enfin, il est possible de repenser la forme même de ces revues. Pourquoi ne pas associer la force de l’oralité à l’analyse critique ? Des formats hybrides, à deux voix, mêlant chronique populaire et regard journalistique, pourraient offrir une information à la fois accessible, crédible et ancrée dans nos réalités.
La revue de presse, à mi-chemin entre information et opinion, peut être un puissant outil d’éducation et de lien avec les citoyens. Mais pour cela, elle doit sortir de sa zone grise actuelle et mettre l’oralité au service de la vérité, de la nuance et du débat citoyen, plutôt que de la désinformation.











